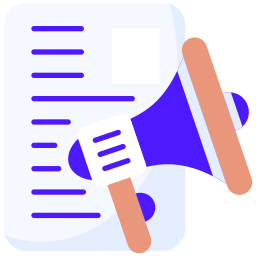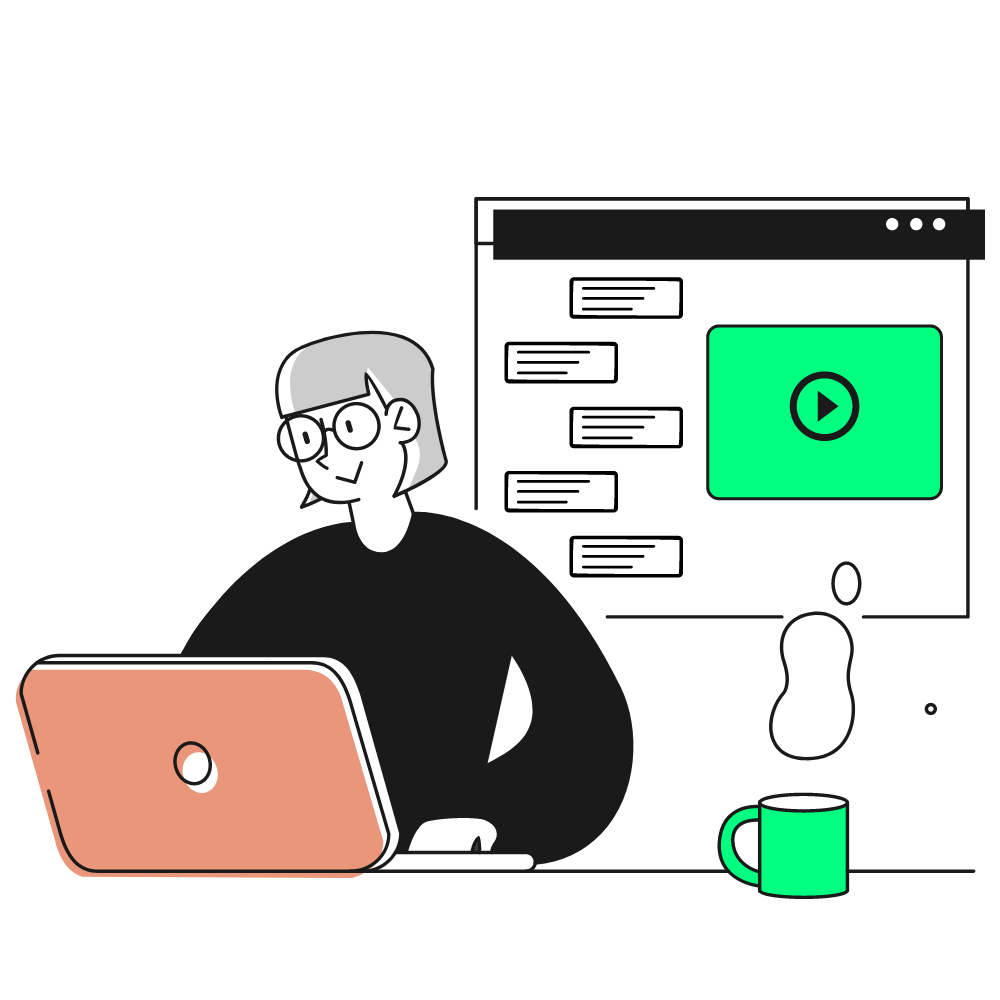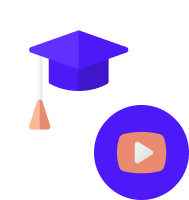Fiscalité
Impôts : le droit à l'erreur remis en question ?
Une décision du Conseil d'État du 9 mai remet-elle en question le fameux droit à l'erreur, symbole d'une administration plus clémente et ouverte au dialogue ? Retour sur un coup de théâtre juridique qui risque de changer la donne pour les contribuables.
Qu'est-ce que le droit à l'erreur ?
Instauré par les gouvernements successifs, le droit à l'erreur permet aux contribuables de corriger leur déclaration fiscale sans encourir de pénalités, sous réserve de bonne foi. Cette mesure vise à simplifier les démarches administratives et renforcer la confiance entre l'administration et les particuliers. Le principe est simple : l'administration doit prouver l'erreur ou la mauvaise foi pour appliquer une sanction, et non l'inverse.
Comment ça marche ?
Avant la clôture de la période déclarative, le contribuable peut modifier librement sa déclaration.
Après la période de déclaration, un service de correction en ligne reste accessible de début août à début décembre pour ajuster les informations, sauf celles liées à l'identité ou à la situation familiale.
Cette procédure permet d'éviter un contentieux fiscal en rectifiant directement les erreurs sans litige.
La décision du Conseil d'État : ce qui change
Dans sa décision du 9 mai (référence n°496935), le Conseil d'État a rendu un arrêt qui limite drastiquement l'intérêt de cette correction en ligne. Le cas concerne un couple de contribuables, victimes d'une escroquerie de type pyramide de Ponzi, qui ont souhaité rectifier leur déclaration après la date limite pour requalifier des revenus en remboursement de prêts.
L'administration fiscale a rejeté cette modification, argumentant que la correction en ligne ne pouvait concerner qu'une augmentation des revenus déclarés. La Cour administrative d'appel de Paris leur avait donné raison en juin 2024, mais le Conseil d'État est allé dans l'autre sens. Il considère que toute correction après le délai est une réclamation contentieuse, transférant la charge de la preuve… au contribuable.
Conséquences pratiques :
Le communiqué ministériel de 2017, qui ouvrait le droit à la correction en ligne, n’a plus de valeur juridique. Toute modification après la date limite est désormais une réclamation, impliquant une procédure contentieuse. Le contribuable doit désormais prouver l'erreur pour toute modification à la baisse, ce qui complexifie grandement les démarches.
Comment agir face à cette nouvelle donne ?
La décision du Conseil d'État complique le recours à la correction en ligne. Pour éviter les mauvaises surprises, voici quelques conseils pratiques :
En cas de doute, déclarez un peu moins que prévu : si vous n'êtes pas certain d'un montant, il vaut mieux ajuster à la baisse lors de la déclaration initiale. En effet, c'est à l'administration de prouver le contraire.
Utilisez la mention expresse : cette option vous permet de signaler une incertitude lors de la déclaration. Elle sert de justificatif si l'administration remet en question le montant déclaré.
Corrigez rapidement dès que l'information est disponible : si vous obtenez des précisions après la déclaration, rectifiez à la hausse le plus tôt possible.
Les modifications à la baisse, une voie de plus en plus étroite
Désormais, l'outil de correction en ligne semble réservé principalement aux augmentations de revenus déclarés. Les modifications à la baisse, elles, relèvent du contentieux, un chemin bien plus complexe et incertain.
Pourquoi ?
Selon le Conseil d'État, une correction après le délai légal ne peut être opposée à l'administration, même si le ministre de l'Action et des Comptes publics avait promis l'inverse en 2017. En d'autres termes, le droit à l'erreur s'amenuise considérablement pour les contribuables souhaitant réduire leurs revenus déclarés après le délai.
Vers un droit à l'erreur… à sens unique ?
Avec cette décision, le droit à l'erreur semble désormais à sens unique : il faciliterait les déclarations majorées, mais complexifie drastiquement les rectifications à la baisse. Un paradoxe qui ne manquera pas d'alimenter le débat sur l'équilibre entre confiance administrative et contrôle fiscal.
L'avenir dira si le législateur décidera de clarifier cette situation pour redonner tout son sens à ce droit promis comme un vecteur de confiance entre citoyens et administration.
%20(1000%20x%20300%20px).png)